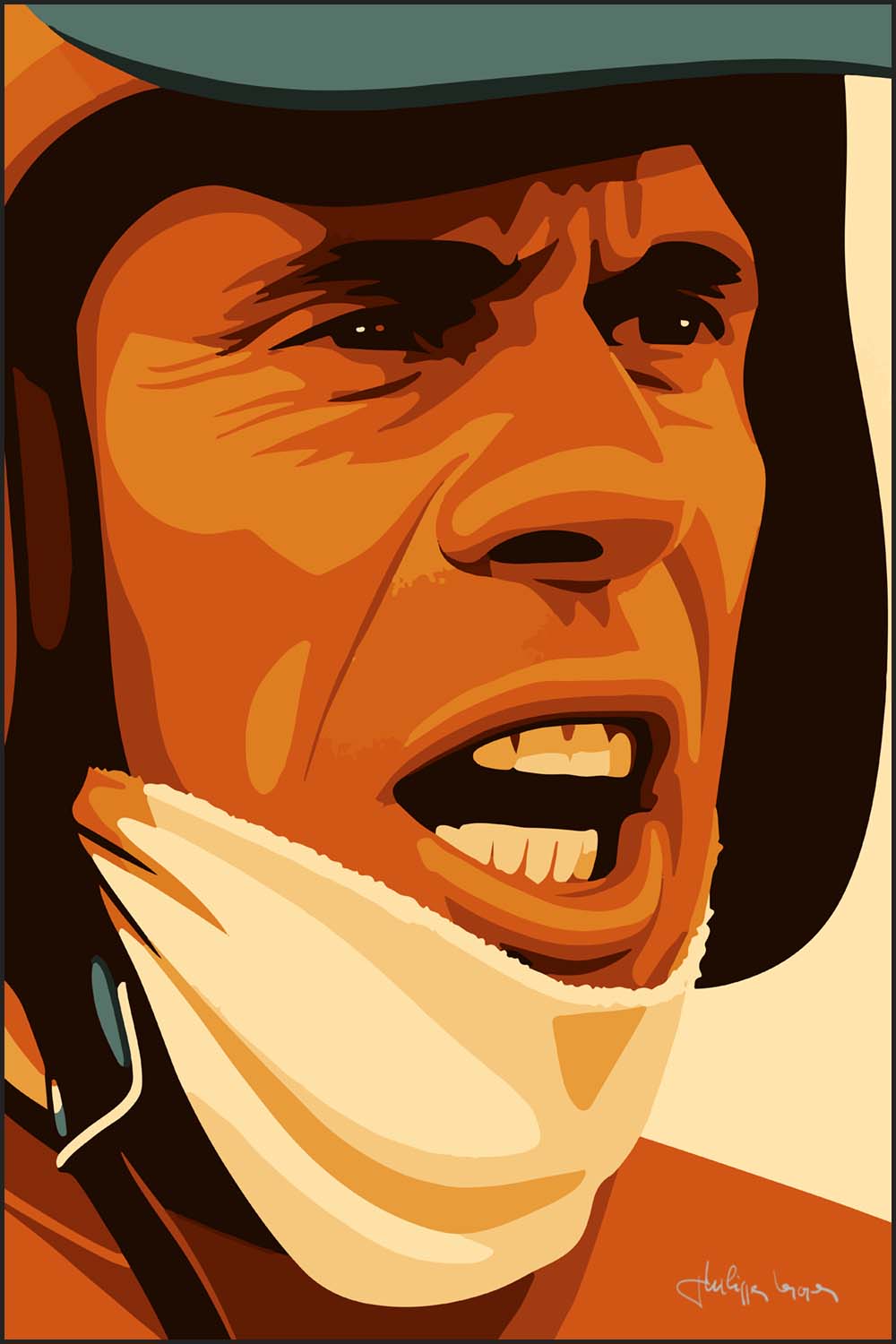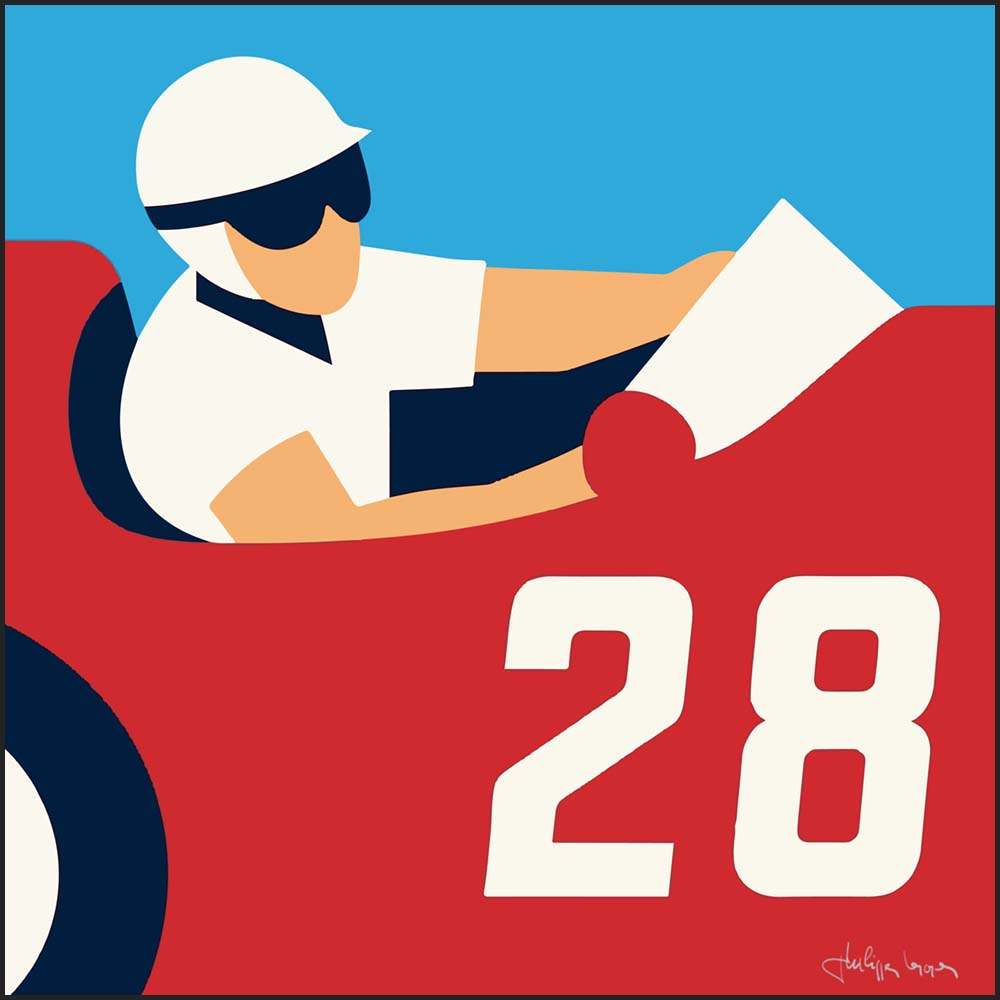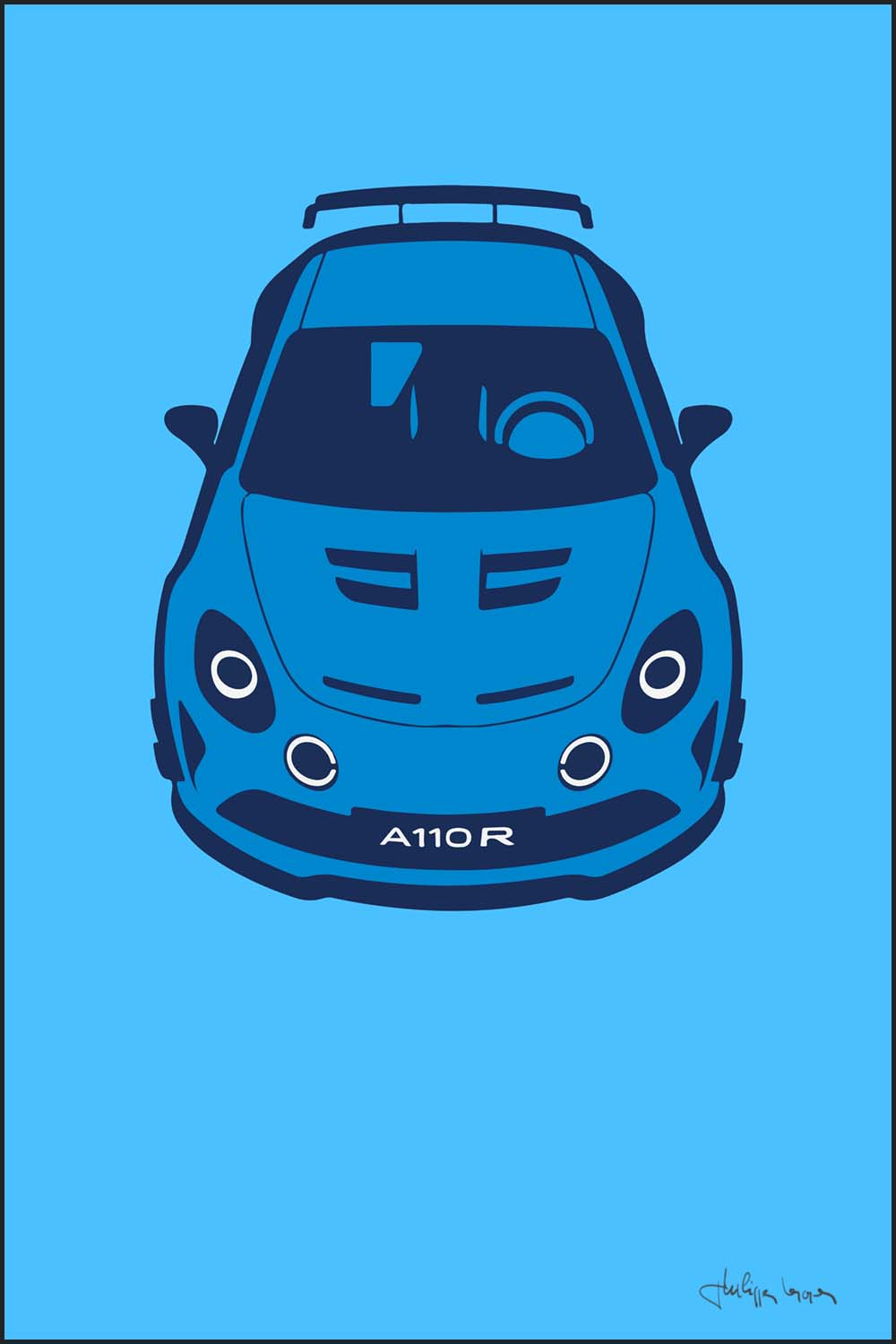admin3807
admin3807
Jim Clark portrait – minimalist art print
Jim Clark illustration mixte dessin/palette graphique 70 x 120 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Alpine Renault et Ferrari 512 B – minimalist art print
Alpine Renault et Ferrari 512 B illustration mixte dessin/palette graphique 70 x 120 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Minimaliste art print automobile – Collection fin 2025
Illustration mixte dessin/palette graphique s’inscrit dans 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Ferrari 50′ – minimalist art print
Ferrari 50′ illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Porsche 917 – minimalist art print
Porsche 917 illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Porsche 917 et Ford GT40 – minimalist art print
Porsche 917 et Ford GT40 illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Bugatti 35 – minimalist art print
Bugatti 35 illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Alpine A110R – minimalist art print
Alpine A110R illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 55 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“
Auto Union Type A – minimalist art print
Auto Union Type A illustration mixte dessin/palette graphique 85 x 85 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“